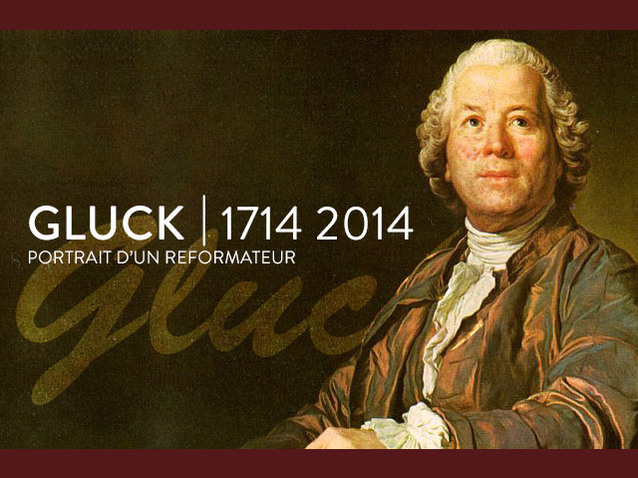 © OOL
© OOL
Il y a trois cent ans naissait en Bavière un musicien dont le rayonnement peut sembler limité en comparaison de son rôle dans l’histoire de l’opéra. Ce compositeur dont la riche carrière musicale se développa à travers l’Europe des Lumières, fut à l’origine d’un renouvellement décisif dans la conception de la dramaturgie lyrique. Parcourir à sa suite les grandes étapes de sa réforme esthétique offre une passionnante occasion de s’interroger sur des notions essentielles pour l’amateur d’opéra. Gluck recherchait plus de simplicité dans l’action, plus de naturel dans le chant affranchi des ornements de la virtuosité. Des exigences nouvelles le portaient vers l’expression sensible de sentiments propres à émouvoir. Le compositeur réformateur annonce clairement son projet dans la préface d’Alceste (1767) : « J’ai cherché à réduire la musique à sa véritable fonction, celle qui consiste à seconder la poésie afin de renforcer l’expression émotionnelle et l’impact des situations dramatiques sans interrompre l’action et sans l’affaiblir par des ornements superflus ». Avec Gluck qui définissait sa musique comme « le langage de l’humanité », l’opéra allait s’éloigner des tyrannies de l’hédonisme musical pour devenir une tragédie lyrique où s’exprimeraient avec le plus de naturel possible la vérité des passions.
Les années de formation
La carrière de Christoph Willibald Gluck se présente d’emblée comme le résultat d’une succession de rencontres déterminantes, autant pour sa formation que pour son évolution théorique future. C’est grâce à la protection du Prince Lobkowitz, pour lequel travaillait son père comme garde forestier, que le jeune Gluck, bravant l’hostilité paternelle, partit séjourner à Prague, à Vienne et à Milan où il fut l’élève de l’éminent Sammartini. Auprès de ce célèbre pédagogue connu dans l’Europe entière, Gluck acquiert une solide technique de composition dans le plus pur style italien.

Il manifeste très vite un intérêt exclusif pour l’écriture d’ouvrages lyriques. Il en composera plus d’une centaine. Rompu aux règles de l’ « opera seria » dont la construction repose sur la mise en valeur de la virtuosité, le jeune compositeur fait ses débuts à Milan où est créé Artaserse en 1741. Le livret est signé par le poète italien Métastase (1698-1782). C’est un triomphe qui lui vaut une série de commandes. Ses 21 premiers opéras, dont il ne reste souvent que des fragments, seront joués dans les plus grands théâtres d’Europe.
L’année 1754 marque le début de sa carrière officielle. Il s’installe à Vienne où il est nommé maître de Chapelle de l’impératrice Marie-Thérèse, ce qui lui donne l’occasion de faire une autre rencontre importante, celle du comte Durazzo, directeur des opéras de la Cour. Grâce à lui, il découvre l’opéra-comique français qui le séduit en lui ouvrant d’autres horizons. Gluck entretient une correspondance avec Charles-Simon Favart (1710-1792) maître de ce genre typiquement français. Il compose dès 1758 toute une série d’opéra-comique, parmi lesquels Le Diable à quatre (1759) ou Le Cadi Dupé (1761). Il approfondit ainsi les possibilités qu’offrent la « sincérité » et le « naturel » des personnages mis en scène dans ce type d’ouvrages, construit sur une alternance de dialogues parlés et de parties musicales. La rupture y est totale avec le langage factice et les intrigues compliquées de l’opéra italien.
Le véritable tournant de sa carrière s’annonce avec une nouvelle rencontre décisive, celle d’un homme de lettres italien attiré par les nouvelles conceptions esthétiques portées par Diderot et Rousseau : le librettiste Raniero di Calzabigi (1714-1795) dont l’ambition est de renouveler l’opéra. Avec l’aide de ce brillant théoricien, Gluck va se lancer dans une ambitieuse réforme du drame lyrique.
Le temps de la réforme
C’est bien avec l’intention de débarrasser l’opéra de ses excès pour le rapprocher de la vérité, que Gluck et Calzabigi créent Orfeo et Euridice en 1762 au Burg-Theater de Vienne. Jusqu’à cette date le musicien reste « un italien », même si son approche de l’opéra-comique français lui a ouvert de nouvelles perspectives. Orfeo et Euridice, dont Calzabigi a écrit le livret, constitue la première tentative de mise en œuvre de « la réforme de l’opéra » voulue par Gluck : « Je me suis proposé de dépouiller la musique des abus qui, introduits par la vanité mal entendue des chanteurs ou par une complaisance exagérée des maîtres, défigurent depuis longtemps l’opéra italien… Je pensais à restreindre la musique à son véritable office qui est de servir la poésie pour l’expression sans interrompre l’action et sans la refroidir par des ornements superflus ». Cette nouvelle exigence, qui remet en cause la suprématie de la virtuosité chère au « bel canto », entend privilégier une expression musicale stylisée épousant les inflexions naturelles du langage parlé. Le chant, expression de l’intériorité des personnages, doit respecter les nécessités du développement d’une intrigue resserrée.
Le castrat-alto Guadagni qui tenait le rôle-titre lors des représentations viennoises d’Orfeo et Euridice continue cependant à improviser de spectaculaires ornementations pour faire admirer sa longueur de souffle. Il ne renonce pas à introduire un de ces fameux airs « de malle », ainsi appelés parce que les chanteurs les emportaient dans leurs bagages pour les utiliser durant les représentations d’opéra, au moment qui leur semblait bon, sans aucun souci de lien avec le déroulement de l’intrigue. Tous ces excès de l’ « opera seria » commencent à heurter les goûts d’un public en pleine évolution dans cette seconde moitié du XVIIIème siècle.
La préface d’Alceste 1767
Alceste, créée en 1767, marque l’étape décisive de la réforme entreprise par Gluck. Dans l’épître dédicatoire au duc de Toscane, qui sert de préface à cette œuvre-manifeste, se trouve exposés tous les choix qui ont guidé le compositeur. Loin des artifices d’une virtuosité inutile, Gluck recherche la fluidité en abandonnant le principe de la séparation entre le récitatif et l’air. La recherche d’une continuité musicale assurant la tension dramatique apparaît comme un apport majeur. C’est pour mieux l’atteindre que tous les éléments sont subordonnés et intégrés à l’action à commencer par l’ouverture qui annonce le drame. Les chœurs et les ballets ne sont plus des ajouts extérieurs à l’intrigue. Tous les éléments du drame ont leur utilité et concourent à un seul but : toucher et émouvoir le public par une peinture fidèle des sentiments.
L’idéal de la vérité des émotions, secondée par la recherche d’une simplicité naturelle dans l’expression chantée, se réalise dans Iphigénie en Aulide, créée à Paris en 1774 avec le soutien de la reine Marie-Antoinette, ancienne élève de Gluck. Cette « tragédie-opéra » dont le livret est adapté de l’Iphigénie de Racine, assure définitivement le triomphe du compositeur venu s’installer à Paris.
Une guerre très parisienne
En 1777, le Paris musical est en ébullition : Armide, composée sur un livret de Quinault, met le comble à une querelle qui s’envenime dans la presse parisienne entre les partisans du nouvel opéra français et ceux de l’opéra traditionnel italien. Le clan des « gluckistes » affronte le clan italianisant qui se choisit comme champion un très bon compositeur italien, Niccolo Piccinni. Les deux musiciens incriminés s’estiment d’ailleurs beaucoup et ne seront jamais en conflit. Leurs partisans respectifs échafaudent cabales et intrigues en obéissant à des motivations qui débordent largement le cadre lyrique. Tous les partisans de Marie-Antoinette étaient de fervents Gluckistes, alors que les Piccinistes regroupaient tous ses détracteurs : Marmontel, d’Alembert et Mme du Barry. Le succès d’Iphigénie en Tauride consacre deux ans plus tard, en 1779, la victoire définitive des partisans de l’opéra français. Cette œuvre apparaît comme le résumé de toutes les avancées musicales souhaitées par le compositeur.
Finissant par apparaître comme le favori de « l’Autrichienne », Gluck devait quitter Paris en 1779 pour revenir à Vienne où il mourut en 1787, deux semaines après la création de Don Giovanni à Prague.
Celui qui rêvait de composer une musique « propre à toutes les nations » a paradoxalement laissé un très grand nombre d’ouvrages composés dans la tradition italienne. Ceux de ses opéras qui suivent les principes inspirés par sa grande réforme sont les moins nombreux – mais les plus donnés et les plus admirés, comme en témoignent les analyses de Richard Wagner ou encore l’enthousiasme d’Hector Berlioz, fascinés par le génie novateur d’une œuvre contradictoire située à la charnière de deux époques. Mozart viendra réaliser et dépasser les promesses musicales et dramatiques contenues dans les grandes œuvres de Gluck.
Catherine Duault
02 juillet 2014 | Imprimer



Commentaires (1)