 © Thibault Vicq
© Thibault Vicq
En verlan, « Gounod » pourrait se prononcer « nos goûts ». Ceux que nous réserve la sixième édition du Festival Palazzetto Bru Zane Paris depuis le 1er juin sont effectivement bien de chez nous. L’événement ranime comme chaque année la musique romantique (voire plus tardive) française sous toutes ses formes, et redore en 2018 le blason de Charles Gounod, dont on fête le bicentenaire de la naissance : une Nonne sanglante mise en scène, et un Faust « originel » en version de concert plus tard, c’est le tour d'un vide-grenier platinum d’arias rares du compositeur qui prend vie à l’Auditorium de Radio France.
Pour filer la métaphore gustative, le legs du musicien préféré de la Castafiore est loin d’être vegan : les textures crémeuses y abondent dans des siphons inépuisables de lyrisme, d’où l’influence de la formation qui l’interprète. Les instrumentistes de l’Orchestre National de France stabilisent leurs couleurs grâce à un son de pupitre émérite, à des sensibles articulations communes et à des signes de vitalité perpétuels. Leur chef assistant (depuis 2017) Jesko Sirvend se tourne vers une épaisse lecture germanique dans la gestion réflexive du tourment des personnages et l’art de la phrase quasi-brahmsienne. Il arrive que l’effectif démesuré de cordes (qu’il guide cependant avec une grande aisance, notamment dans l’extrait de Tobie) et la violence des percussions fassent perdre le naturel frontal du romantisme français, souvent basé sur les basculements harmoniques millimétrés. Les bois sont par moments utilisés comme de (talentueux) solistes-supports et peinent à s’inscrire dans un relief unitaire. La simplicité et l’équilibre qui rendraient l’expression dramatique humaine plus percutante se retrouvent cependant dans les élégants mouvements de valse (heureusement plus parisiens que viennois).
Les deux redoutables parties de la Scène du breuvage, tirée de Roméo et Juliette, n’avaient jamais été mises bout à bout lors d’une représentation de l’opéra, pour ménager la soprane après trois actes déjà intenses ; la jeune Elsa Dreisig se colle à cette création mondiale d’air avec sa traditionnelle fougue. Claire et fine, la voix traduit l’imminence du trépas (du moins supposée, la boisson la faisant passer pour morte aux yeux de sa famille), l‘instant face à soi-même où il est inutile de se mentir, dans une gradation dramatique. Elle ordonne sans se retourner l’art de la mélodie dans un puzzle psychologique.
La même détermination se retrouve chez Jodie Devos, mais sans autant de fluidité grisante. La richesse des émissions l’expose à une dynamique plus hachée. Le code de conduite automatique des appoggiatures forte non-vibrées suivies d’une note plus légère, par exemple, handicape la pureté et les nuances de son chant. La projection trouve en revanche le juste milieu entre la déclamation et la musicalité, comme chez sa comparse Kate Aldrich. Celle-ci suspend par ailleurs son souffle dans des piano féeriques, qui s’étagent progressivement au contact de l’orchestre, malgré un vibrato trop large.
Si le ténor Yosep Kang pèche ponctuellement par une semi-justesse, ses intentions séduisent par l’orientation de ses phrases. Son expressivité est dénuée de fausse théâtralité, constituant un plus pour ses aigus jaillissants et son timbre de soie. La sonorité résineuse de Patrick Bolleire accompagne le raffinement de son Soliman (La Reine de Saba) et la solidité de ses interventions en quatuor. La basse solaire s’anime d’une prosodie s’adaptant à tous les terrains dans un contrôle rigoureux. Si la direction de Jesko Sirvend est attentive aux inflexions rythmiques des chanteurs (l’extrait de Mors et Vita en témoigne), des ajustements de volume restent à appliquer pour que les instrumentistes ne couvrent pas les chanteurs.
Mais le propre de la crème fouettée n’est-il pas de revêtir les récipients jusqu’à en avoir mal au ventre ? Ici, point d’indigestion ; seulement la sensation d’avoir commandé un dessert tantôt trop lourd et recherché.
Thibault Vicq
(le 16 juin 2018)

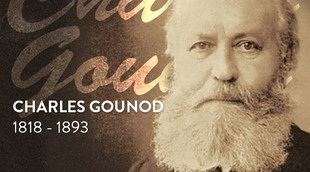
Commentaires