 © OOL
© OOL
Musicien brillant avant d’apprendre la composition auprès de professeurs illustres, Giacomo Meyerbeer s’est imposé comme l’un des représentants emblématiques du « grand opéra » et du romantisme. Et si plusieurs de ses œuvres ont été acclamées par le public, il a aussi eu à subir une critique virulente, jusqu’à (presque) sombrer dans l’oubli dès la fin du XIXème siècle. On tend néanmoins manifestement aujourd’hui à redécouvrir son œuvre (notamment à l'Opéra de Paris qui programme une nouvelle production des Huguenots), et nous en profitons pour retracer le parcours et les influences du compositeur.
***
Que serait l’opéra du XIXème siècle sans l’art de Giacomo Meyerbeer, qui a fait briller son nom au firmament de l’Opéra de Paris en donnant ses lettres de noblesse à un nouveau style lyrique, le « grand opéra » ? Et pourtant, combien de mélomanes seraient capables de citer ses plus grands succès ? Il y a peu d’exemples d’un oubli aussi injuste après une telle célébrité. Comment imaginer aujourd’hui les triomphes et les multiples honneurs qui firent de ce compositeur une des gloires internationales de son temps ? Sait-on qu’il a impressionné Rossini, et influencé Gounod, Verdi, et Wagner, même si ce dernier l’a ensuite accablé de propos antisémites en oubliant qu’il l’avait généreusement aidé ! Quand Meyerbeer meurt en 1863, ses contemporains déplorent la disparition d’un des plus grands génies musicaux de tous les temps…
Au cœur de l’imaginaire romantique
En 1831, avec Robert le Diable, Giacomo Meyerbeer inaugure une nouvelle ère de l’histoire du théâtre lyrique. Le retentissement de ce mélodrame historique à grand spectacle est immense, car il s’impose comme le prototype parfait du « grand opéra à la française », fidèle reflet d’une certaine démesure de l’époque romantique. Meyerbeer semble s’inscrire dans le sillage de la fameuse « bataille d’Hernani » qui « révolutionne » en 1830 les anciens principes de la création théâtrale remis en cause par Victor Hugo (1802-1885). Désormais, comme le proclame l’écrivain dans sa Préface de Cromwell (1827), le drame romantique montrera que « le laid existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la lumière. »
Meyerbeer participe pleinement à cette révolution esthétique en exploitant la mode du roman historique. Dans le « grand opéra », l’intrigue est basée sur un conflit entre l’action individuelle et le drame collectif. Les grands sentiments se mêlent à des enjeux exaltants comme la rébellion contre une oppression politique, ou la lutte contre l’intolérance religieuse. Le pittoresque, le mystère, et les affres de la passion sont magnifiés par une écriture orchestrale faite de puissants contrastes tandis que des masses chorales impressionnantes évoluent au milieu de somptueux décors d’un réalisme saisissant pour l’époque. Le tout est encore rehaussé par des jeux de lumière « cinématographiques » avant la lettre. Comme l’annonce Eugène Scribe (1791-1861), le librettiste emblématique du « grand opéra », désormais on verra sur scène « du gracieux, du terrible, du vrai, du fantastique, (…) enfin des choses qui feront louer les loges pendant six mois ». Telles sont les clefs d’une nouvelle formule lyrique qui part à la conquête du public de la Monarchie de Juillet. Les idéalistes et les envieux auront beau se récrier, Meyerbeer et Scribe rempliront les caisses de l’Académie royale de musique dont l’heureux directeur est le docteur Véron (1798-1867), un entrepreneur privé qui a fait fortune grâce à une pâte pectorale ! Nous sommes en plein univers balzacien où le héros éponyme de César Birotteau (1837) peut croiser le chemin du compositeur Gambara auquel Balzac confie la défense de Meyerbeer dans la nouvelle qui porte son nom : Gambara (1837). Curieusement, c’est sous l’influence de l’alcool que Gambara exalte le talent de Meyerbeer qui sait si bien allier l’intérêt dramatique à l’expression mélodique de sentiments puissants. Mais ce qui s’accordait au goût de l’amateur d’opéra de 1830 semble être devenu très vite le comble du mauvais goût et de la facilité. Et Balzac semble l’avoir pressenti, car, une fois délivré des vapeurs de l’alcool, Gambara se rallie à ceux qui dénoncent chez Meyerbeer « le pénible travail d’un esprit fin qui a trié sa musique dans des milliers de motifs des opéras tombés ou oubliés pour se les approprier en les étendant, les modifiant ou les concentrant ». C’est exactement ce que l’on reprochera bientôt à Meyerbeer dont le style éclectique sera fortement critiqué. On ne lui pardonnera pas de remporter un succès qui dérange parce qu’il est basé sur la réunion de plusieurs genres disposés en une vaste palette de formes et de styles.

Julie Dorus-Gras
La plupart des ouvrages de Meyerbeer vont connaître la disgrâce dès la fin du XIXème siècle, puis ils seront rapidement ensevelis sous d’impitoyables préjugés esthétiques auxquels s’ajouteront pour les interprètes, la crainte de devoir se mesurer à de périlleuses difficultés vocales. Ainsi dans Les Huguenots (1836) sont réunis sept rôles importants qui ont été créés par les plus grands chanteurs du XIXème siècle comme le ténor Adolphe Nourrit (1802-1839), la soprano Julie Dorus-Gras (1805-1896), ou encore Cornélie Falcon (1814-1897), qui a donné son nom à un type de soprano dramatique.
Avoir fait rêver la bourgeoisie triomphante deviendra un crime artistique impardonnable, surtout quand Richard Wagner imposera une vision noble et quasi mystique du drame musical. Pourtant, le succès de Meyerbeer n’est pas dû au hasard ou aux caprices d’une mode passagère, car son œuvre offre une conception soigneusement élaborée d’un type de spectacle total où se trouvent savamment associés effet musical et effet dramatique. L’art de Meyerbeer peut encore exercer son pouvoir de séduction à l’orée du XXIème siècle et « l’ère du soupçon » semble devoir toucher à sa fin.
Une vie protégée
Selon la formule d’Hector Berlioz, Meyerbeer avait « le bonheur d’avoir du talent et le talent d’avoir du bonheur ». Cela suffit parfois à constituer une circonstance défavorable aux yeux de la postérité. Si le compositeur a su incarner le romantisme en musique, sa vie est bien trop lisse et réussie pour susciter la curiosité. Dans cette existence entièrement vouée à la musique, on cherche vainement la trace de tourments financiers ou les éclats d’une vie sentimentale émaillée de liaisons orageuses avec telle ou telle interprète. En 1827, le musicien épouse une cousine germaine, Mina Mosson, qui a été l’unique amour de sa vie. Ils auront cinq enfants dont les deux premiers sont morts en bas âge. Meyerbeer semble avoir été un homme d’une grande rectitude morale et intellectuelle, et tout en étant une des personnalités musicales les plus en vue de la première moitié du XIXème siècle, le musicien a su préserver son intimité. Son testament stipulera que ses manuscrits et son journal intime doivent rester confidentiels jusqu’à la mort de ceux qui y sont cités, et ce n’est qu’en 1916 que sa fille les remettra à la Preussische Staatsbibliothek de Berlin, à condition qu’ils ne soient pas divulgués avant 1935… Ces précautions ajoutées aux méfaits de la période nazie expliquent les difficultés que rencontrent les chercheurs désireux d’approfondir la connaissance de la vie du compositeur.
Une jeunesse heureuse
Jakob Liebmann Meyer Beer est né le 5 septembre 1791 dans les environs de Berlin. Son acte de naissance mentionne qu’il se prénomme Meyer, et ce n’est qu’à l’âge de 19 ans que le musicien choisira d’adopter officiellement le nom de Meyerbeer. Aucun document ne permet de valider la thèse selon laquelle il aurait réuni « Meyer », son troisième prénom, à « Beer », le nom de son père, dans le seul but de pouvoir hériter d’un lointain parent.
Le père du compositeur a fait fortune dans le commerce du sucre. Il a épousé une femme extrêmement cultivée, Amalia, avec laquelle il aura quatre fils. Jakob est l’aîné d’une fratrie qui partage une enfance heureuse dans un foyer aimant. Amalia conservera une profonde influence sur son premier fils comme en témoigne la correspondance qu’elle entretient avec lui jusqu’à sa mort en 1854. Pour Meyerbeer, elle restera toujours « l’ange protecteur, le bon génie de (la) famille ». Un des frères du musicien deviendra le créateur du réseau de chemin de fer prussien tout en laissant d’importants travaux d’astronomie. Le dernier fils sera quant à lui poète et dramaturge. Le salon de la famille Beer est un des lieux les plus brillants de la vie mondaine et intellectuelle berlinoise où l’on peut croiser des compositeurs comme Ludwig Spohr (1784-1859) ou Ignaz Moscheles (1794-1870).
Le jeune Jakob s’épanouit donc dans le cadre protecteur d’une très riche famille juive de Berlin, où il bénéficie d’une solide éducation. Il apprend l’hébreu, le latin, le grec mais aussi l’italien et le français, sans oublier les mathématiques. Il étudie aussi le piano, et devient rapidement un petit prodige. Son premier professeur de piano est Franz Lauska (1764-1825). L’enfant fait ses débuts en public à l’âge de onze ans. Excellent improvisateur et parfait virtuose, Meyerbeer aurait pu envisager de faire carrière comme exécutant plutôt que comme compositeur. Carl Maria von Weber (1786-1826), dont il est devenu l’ami, n’hésite pas à dire de lui qu’il est « peut-être le premier pianiste de (son) temps ».

Georg Joseph Vogler
Meyerbeer étudie la composition avec Bernhard Anselm Weber (1766-1821), frère de Carl Maria, et avec Carl Friedrich Zelter (1758-1832), l’ami de Goethe, et le professeur de Mendelssohn. C’est sans doute sous l’influence de Weber que le jeune homme fait ses « premiers pas musicaux » dès l’âge de 18 ans, avec des œuvres comme Le Pêcheur et la Laitière, un ballet-pantomime créé au Théâtre royal de Berlin en 1810. C’est aussi en 1810 que Meyerbeer part à Darmstadt pour étudier chez l’abbé Georg Joseph Vogler (1749-1814), que l’on considère comme le premier musicien allemand de cette époque. On peut s’étonner qu’un jeune juif berlinois ait choisi de se perfectionner sous la férule d’un abbé qui l’initie à l’art de composer des cantiques. Cela prouve que la famille Meyerbeer plaçait l’art au-dessus de toute considération religieuse. Le compositeur restera toujours fidèle à sa religion qu’il pratiquera avec une ferveur sincère, quoique discrète.
Après un oratorio, Dieu et la Nature, représenté au Théâtre national et royal de Berlin en 1811, Meyerbeer écrit son premier opéra, Le Serment de Jephté, un « singspiel » avec dialogue parlé, créé en 1812 à l’Opéra de cour de Munich. Cet opéra biblique est bientôt suivi d’un opéra-bouffe, Hôtelier et Convive (1813), inspiré des Mille et Une Nuits. La majeure partie de ces ouvrages de jeunesse est aujourd’hui perdue et il est assez difficile de s’en faire une idée. Ce qui est certain, c’est que la carrière de Meyerbeer ne démarre pas aussi bien qu’il l’espérait. Ce serait Antonio Salieri (1750-1825) qui lui aurait recommandé de partir à la conquête du pays qui a vu naître l’opéra, l’Italie.
Giacomo
Le jeune Allemand est aussitôt conquis par l’Italie et il s’intègre si parfaitement à sa vie musicale qu’il décide de changer son prénom pour devenir Giacomo Meyerbeer. Bien plus tard, il expliquera : « Je ne voulais pas, comme on se l’imagine, imiter Rossini ni écrire à l’italienne, mais il me fallait composer dans le style que j’ai adopté, parce que mon état d’âme m’y contraignait ». Pendant une dizaine d’années, le compositeur affine sa maîtrise du théâtre lyrique en approfondissant son art du chant.
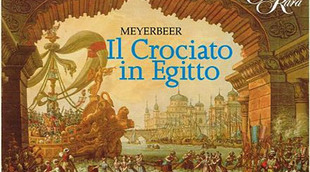
Il Crociato in Egitto (1824)
C’est à Padoue que Meyerbeer compose Romilda et Constanza (1817) le premier opéra qui lui apporte le succès. A 26 ans, Giacomo commence à « percer » en travaillant avec le librettiste Gaetano Rossi (1774-1855), une sorte d’Eugène Scribe italien, qui lui ouvre les portes de Turin pour sa Semiramide riconosciuta (1819), et lui permet de créer à Venise, Emma di Resburgo (1819). La même année, Meyerbeer écrit Margherita d’Anjou avec Felice Romani (1788-1865), un autre grand librettiste italien. Les ouvrages de cette période reflètent l’univers romantique où s’épanouissent les intrigues amoureuses en conflit avec une société qui cherche à contraindre la liberté individuelle.
La carrière du jeune Berlinois progresse à pas de géant. On loue déjà son habileté à manier la couleur orchestrale pour refléter les sentiments de ses personnages et on remarque son souci constant d’accomplir la synthèse de différents styles. En 1824, Il Crociato in Egitto est créé à la Fenice de Venise. C’est la consécration de la carrière « italienne » de Meyerbeer qui va suivre jusqu’à Paris son idole, Gioacchino Rossini (1792-1868), de six mois son cadet. Mais à 37 ans, Rossini met un terme à sa carrière. Il n’écrira plus un seul opéra. Il se contentera désormais de passer une vie agréable à Paris où il recevra toute l’Europe musicale, comblé d’honneurs et de gloire. Quelle est donc la clef de cette énigme ? Après une carrière éblouissante, Rossini aurait-il capitulé devant l’éclatant succès de Meyerbeer ? Certains l’ont prétendu…
A la conquête de Paris
« Jakob » était devenu « Giacomo » en Italie. A Paris, il deviendra « Jacques ». Meyerbeer aura donc porté trois prénoms différents au fur et à mesure de sa carrière européenne. Comme le soulignait le célèbre critique Eduard Hanslick quand il évoquait Meyerbeer en 1891 : « L’Europe était son Bayreuth ». Mais c’est à Paris qu’il faut réussir pour s’assurer une renommée internationale. La capitale française est la ville où les artistes sont rois alors qu’à Berlin Meyerbeer se plaint d’avoir été traité sans beaucoup de ménagement.
Le musicien décide donc de se fixer en France tout en continuant à voyager à travers l’Europe. Ces voyages ont souvent pour destination une ville d’eaux où il espère pouvoir raffermir sa santé chancelante.
En 1827, Meyerbeer entame une fructueuse collaboration avec le célèbre auteur dramatique Eugène Scribe (1791-1861), qui va devenir le librettiste incontournable du « grand opéra ». Edouard Hanslick a bien cerné le précieux talent de cet homme qui, sans connaître la musique, avait « le génie des situations dramatiques qui ouvrent de nouvelles voies à la musique tout en recevant de celle-ci toute leur valeur ». Très recherché par les compositeurs, Scribe n’aura aucune difficulté à s’imprégner du romantisme ambiant et il accompagnera l’engouement du public pour les drames historiques. Boieldieu, Donizetti, Gounod, Offenbach, mais aussi Rossini et Verdi figurent sur la liste prestigieuse des musiciens qui ont travaillé avec Scribe pour qui l’efficacité scénique prime sur la valeur littéraire des livrets.
Au moment où il triomphe avec Robert le Diable, en 1831, Meyerbeer a 40 ans. Du jour au lendemain, il devient la coqueluche de Paris en rencontrant un des plus grands succès de tous les temps. Moins de trois ans après sa création, l’ouvrage en était déjà à sa centième représentation et il figurait à l’affiche de soixante-dix opéras dans dix pays différents ! Tous les mélomanes ont à l’esprit la fameuse cavatine d’Isabelle, « Robert, toi que j’aime ». Comment imaginer aujourd’hui l’immense retentissement de ce mélodrame historique à grand spectacle dont le succès mémorable se prolongea sans faiblir jusqu’en 1893 ? D’abord conçu en 1827 comme un opéra-comique, l’ouvrage s’est transformé en un grand opéra en cinq actes au cours d’une genèse des plus laborieuses dont témoigne un évident éclectisme musical. Rassemblant tous les thèmes de l’imaginaire romantique, le livret de Scribe reprend une légende populaire normande qui se déroule dans un Moyen-Age de style « troubadour ». L’éternelle lutte entre le bien et le mal constitue la trame essentielle de l’intrigue de Robert le Diable. Ce type de « spectacle total » mobilise toutes les ressources de la scène pour obtenir la plus grande efficacité dramatique. Selon la belle formule de Balzac, l’opéra de Meyerbeer apparaît comme « le temple de l’illusion et du miracle ». Au XVIIème siècle, la tradition versaillaise de « l’opéra à machines » n’avait pas d’autre ambition. Meyerbeer n’est pas dupe de la surenchère de décors et d’effets spéciaux mis à sa disposition par Louis Véron, le directeur de l’Opéra : « Tout cela est très beau », lui dit-il, « mais vous ne croyez pas au succès de ma musique, vous cherchez un effet de décorations ».
Un compositeur méticuleux
Dès l’écriture de Robert le Diable apparaît une des caractéristiques de la façon dont compose Meyerbeer. Il consacre de longues périodes à son travail, n’hésitant pas à retoucher, modifier, ou écrire beaucoup plus de musique que nécessaire. Ce n’est pas un musicien prolifique, et les trois opéras qu’il écrit pour Paris, Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836) et Le Prophète (1849), lui ont suffi pour éclipser de son vivant beaucoup d’autres ouvrages.

Robert le Diable
Meyerbeer est un travailleur infatigable. Le 5 septembre 1855, pour ses 64 ans, il note ces résolutions dignes d’un débutant : « 1. Chaque jour composer quelque chose, quoi que ce soit. 2. Fixer un jour dans la semaine pour répondre aux lettres reçues. 3. Lire toujours un livre classique. 4. Se consacrer aux aspects théoriques et esthétiques de la musique. 5. Si je ne compose pas, au moins improviser une fois par jour au piano ». On s’étonne d’une telle rigueur et surtout d’une telle humilité chez un compositeur adulé dans toute l’Europe !
Quand le moment des répétitions arrive, le musicien devient intraitable. L’écrivain allemand Heinrich Heine (1797-1856) rapporte que, lorsqu’il fait étudier un nouvel ouvrage, Meyerbeer est « le fléau de tous les musiciens et chanteurs qu’accablent des répétitions incessantes. »
En 1842, Meyerbeer accepte le poste de directeur général de la musique du royaume de Prusse. Il écrit différents ouvrages comme Le Camp de Silésie (1844) ou Struensée (1846) une musique de scène pour un drame écrit par son frère Michael. En 1848, le compositeur revient à Paris où il reconquiert son public avec Le Prophète (1849). L’année 1853 sera celle de L’Etoile du Nord, un opéra-comique qui lui permet de réaliser un vieux rêve qu’il poursuivra avec Dinorah ou le Pardon de Ploërmel (1859). Mais dès 1857, Meyerbeer se sent vieux, et constate : « mon étoile descend sous l’horizon… ». Le vide commence à se faire autour de lui ; ses amis meurent, et Richard Wagner devient son plus farouche détracteur après l’avoir encensé et s’être largement inspiré de lui comme en témoignent ses premières œuvres.
L’Africaine
Les dernières années de Giacomo Meyerbeer sont consacrées à un projet qu’il avait envisagé plus de vingt ans auparavant avec son complice Eugène Scribe, mort en 1861. L’Africaine avait été projetée après la création des Huguenots (1836). L’ouvrage était destiné à mettre en valeur le talent de la célèbre Cornélie Falcon – mais elle perdit ses moyens vocaux et la partition fut mise de côté pendant plusieurs années.
L'Africaine
En avril 1864, Meyerbeer achève L’Africaine et les répétitions peuvent commencer. Malheureusement, la santé du musicien se détériore de plus en plus et il s’éteint à l’aube du 2 mai 1864, sans avoir pu arrêter la version définitive de son ouvrage. Il faut préciser qu’il avait pour habitude d’apporter ses dernières corrections pendant la période des répétitions. Le soin de finaliser la partition fut confié au compositeur belge, François-Joseph Fétis (1784-1871). L’ouvrage remporta le succès escompté lors de sa création en 1865. L’Empereur Napoléon III était présent et le buste de Meyerbeer apparu sur la scène à la fin de la représentation.
L’enterrement de Meyerbeer se déroula à Berlin où il fut l’occasion de grandioses manifestations à la mesure de l’immense notoriété du musicien qui avait influencé tant de ses contemporains, au premier rang desquels Fromental Halévy (1799-1862), l’auteur de La Juive (1835) et autre nom incontournable quand il s’agit du « grand opéra », mais il faudrait citer aussi Gounod, Bizet, Berlioz, Wagner ou Verdi...
25 septembre 2018 | Imprimer




Commentaires